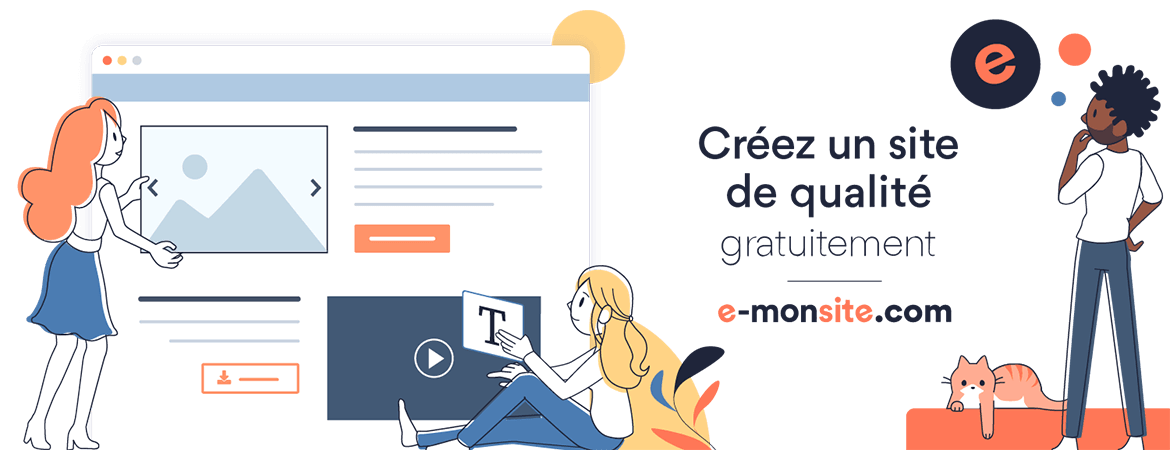Un boufarikois, Ingenio, prisonnier d'Amirouche
Prisonnier dans le maquis d’Amirouche

-Creuse, Kelb !
Dans un sous-bois de châtaigniers, ce cri maitrisé par la haine, résume le drame des deux gardes forestiers indigènes qui, nous le savons maintenant, n’ont pas fait « le bon choix ».
Munis, de deux pelles de fortunes, leur fosse se creuse laborieusement sous l’œil goguenard et pourtant inquiet des gardiens.
Une cinquantaine de soldats dont l’âge ne dépasse pas la trentaine, est en train de vivre un épisode douloureux de cette maudite guerre qui ne veut pas dire son nom. Un grand nombre d’enfants de vingt ans n’en sont pas revenu.
Ce matin-là, l’air est humide. La nuit a été particulièrement pénible car il a fallut s’éloigner du lieu de l’embuscade en marche forcée.
Les prisonniers étaient dans l’ignorance la plus complète de la suite des évènements. Combien de temps nous reste-t-il à vivre ? Quelle est la destination que nous allons prendre après l’épisode des gardes forestiers et le même sort nous est-il réservé ?
Pour définir le rôle des acteurs qui évoluent dans ce drame, il s’agit de mettre au jour les paradoxes de cette situation.
5 février 1958, une quinzaine de rebelles, en tenue disparate, le plus souvent kakie ou encore avec des cachabias rayées, coiffés de casquettes, de calots ou encore de turbans, à la bretelle, des mitraillettes tchèques dernier cri ou de vieux fusils de chasse encore efficaces pour ce genre de guerre, « encadrent » des soldats de l’armée française qu’ils ont capturés la veille.
1
Hier soir, 4 février 1958, malgré le temps maussade, l’ambiance est chaleureuse dans la maison forestière de Lahourane qui sert de poste d’observation au 8ème spahis dont le cantonnement est M’Sila, près de Mélouza (Théâtre d’un horrible massacre attribué à Amirouche).
Autour de la table, une section ( environ vingt hommes ) consomme le sanglier qu’ils ont abattu quelques jours auparavant.
Soudainement, la porte s’ouvre violemment et surgissent dans la pièce deux fellaghas, mitraillette dernier modèle à la hanche. Le plus avancé des deux vocifère : Haut les mains, pas de blague !
Immédiatement les assaillants ouvrent le feu avec une volonté délibérée de neutraliser le maximum, pour ne pas dire la totalité, des opposants à leur dessein.
Après un court instant d’hésitation dubitative, c’est l’affolement de certains novices qui se ruent vers les pièces du fond tandis que d’autres tentent vainement de riposter.
C’est un massacre en règle, une hécatombe.
2
Triste ironie du sort, un des anciens chargé d’extirper les blessés du tas de corps qui gesticulent sous les impacts meurtriers, est réticent à l’idée de faire partie de ce groupe. Il n’est qu’à vingt-quatre jours de la quille. La prémonition sans doute.
Quant aux sentinelles, elles avaient été neutralisées par surprise grâce à la complicité active du sergent Zernou, militaire de carrière de confession musulmane.
De plus certains faits troublants restent encore inexpliqués à ce jour.
Pour exemple ;
- Le sergent Zernou qui essuyait quotidiennement des remarques désobligeantes sur le motif non avoué de son engagement, compte tenu de ses origines, et apparemment non dénuées de fondements si l’on considère la suite des évènements. Ce sergent donc n’était pas correctement surveillé alors qu’il était classé comme élément suspect !
- Pourquoi la liaison radio avec le cantonnement de M’Sila qui habituellement avait lieu toutes les deux heures, ce soir-là resta désespérément silencieuse ?
- Pourquoi enfin avait-on livré la veille un lot impressionnant de munitions dont quatre-vingt mille cartouches.
- Mais surtout pourquoi les rebelles avaient été si vite prévenus ?
Tous ces points restent aujourd’hui encore sont des plus troublants.
3
Donc les rescapés de la fusillade se réfugient dans le mirador central avec leurs armes après avoir condamner les portes blindées.
Le spectacle qui se déroule alors sous leurs yeux est indicible. Dans la cour et aux alentours règne une animation fébrile qui ressemble étrangement à une fourmilière. Une multitude de fellaghas s’active à récupérer les caisses d’armes er de munitions qu’ils arriment solidement aux flancs de mulets impassibles.
Chacun connait sa partition et le pillage s’opère sans gestes inutiles.
Dans leur détermination, l’arrière garde des pillards décide d’incendier les véhicules blindés pour compliquer la tâche d’éventuels fuyards. C’est alors que les réfugiés du donjon-mirador ouvrent le feu à la mitrailleuse et au canon de trente.
La réponse ne se fait pas attendre et après un échange nourri, le chef du commando décide de brûler la tour. Se pose alors au chef de poste un dilemme : Si on ne bouge pas, on est grillé mais si on se rend, on est cuit !...
Heureusement, le lieutenant du 8ème spahis ne copiera pas le fait d’armes de Beni-Mered du sergent Blandan, ce qui permettra à un nombre, certes réduit, de rescapés de sauver leur peau.
4
C’est ainsi que ces braves soldats, emmenés par le lieutenant du poste, décident de se rendre.
Il est alors vingt-deux heures passées de quelques minutes.
Les prisonniers sont alors regroupés à la hâte, sans ménagement, tandis que derrière eux gisent dans leur sang ceux qui ont été abattus ou égorgés, quelque fois les deux.
Une odeur âcre de brûlé et de mort plane maintenant sur les décombres calcinées de la maison forestière de Lahourane et sur les véhicules blindés censés la défendre.
Après une brève halte pour doter les captifs de bleus de chauffe et d’espadrilles, une marche qui durera jusqu’à l’aube, va reprendre.
Enchainés par les poings, individuellement et par groupe de deux, les captifs composant la colonne progressent laborieusement. Le terrain est accidenté, les montées et les descentes se succèdent. Il faut quelques fois patauger ou enjamber des parties très humides, quelques fois des oueds aux cailloux glissants. Quelle galère !
Et malgré la fatigue, tout le monde avance, même les marcheurs occasionnels qui dorment littéralement debout. On devine aisément quel sera le sort réservé aux récalcitrants. Et c’est maintenant que le véritable calvaire commence.
5
Revenons à l’épisode du début où les gardes forestiers creusaient une fosse, copieusement conspués par les gardiens.
Lorsque le trou atteint une profondeur convenable, le bourreau désigné s’empare d’une touffe de bruyère encore pourvue de sa motte de racines en guise de massue.
Deux coups violents sont alors assénés sur la nuque des gardes épuisés par leur travail de terrassement. Leurs corps s’affaissent dans un bruit sourd au fond du trou. Ce fut au tour des prisonniers français de prendre le relai et de remblayer. Ce fut là leur premier travail de captivité.
La fosse comblée, le chef du commando indique la direction à prendre. La colonne s’ébranle, silencieuse…sous le choc.
A cet instant, le doute s’empare des français.
Après avoir assisté à l’exécution sauvage des deux gardes forestiers et sachant que le FLN n’avait jamais fait de prisonniers, il eut fallut être fou d’envisager un heureux dénouement à cette captivité.
Pour autant, les accompagnateurs se font rassurants à leur endroit en affirmant :
- Vous pouvez faire confiance aux combattants algériens, nous sommes une armée régulière et vous serez traités en soldats !
Pour quelles raisons avaient-ils alors remplacé nos uniformes par des bleus de travail et par des savates ?
Sans doute pour respecter la Convention de Genève !?
6
Pour l’heur, continuons de marcher puisqu’on nous intime de le faire.
Tous les hommes sont fatigués, des deux côtés. Il est pourtant essentiel pour la survie du groupe de s’éloigner le plus possible du lieu de l’enlèvement.
Le lendemain, l’aviation pilonnera une zone située aux alentours de Lahourane à plus de quarante kilomètres des fuyards !
Les bruits caractéristiques de cette opération arrivent à leurs oreilles alors que la colonne s’accorde quelques heures de répit dans un bois. Le sourire des gardiens en dit long sur la réussite de leur expédition et sur l’inefficacité de la riposte.
Les nuits succèdent aux jours avec pour programme journalier la marche forcée.
Toujours enchaînés les uns aux autres, ceux qui dorment en marchant sont en quelque sorte portés par les autres.
Le climat est toujours humide et le froid n’arrange pas le moral.
L’incertitude est omniprésente.
Combien de temps va durer ce calvaire ?
Va-t-on nous égorger comme des moutons pour l’Aïd El Kébir ?
Va-t-on servir exceptionnellement de monnaie d’échange ?
Dans ces premiers jours de détention, l’objectif de nos gardiens est de rejoindre une base retranchée dans une zone où l’uniforme français n’a encore jamais été vu par les villageois.
Les règles élémentaires d’hygiène sont réduites à leurs plus simples expressions : Pas de toilettes bien sûr et malheur à celui qui souffre de diarrhée.
La pitance est maigre. Il faut se contenter d’un morceau de galette sèche et compacte et d’une gamelle de thé.
Lorsqu’il y a festin, deux plats de couscous ou plutôt de graines de couscous, nous est servis. Le soir, c’est un bouillon dans lequel nagent quelques os décharnés que l’on va rogner pendant de longs moments pour tromper la faim.
7
Il suffit alors pour améliorer l’ordinaire de se rabattre sur tout élément que l’on estime comestible et que l’on rencontre sur le chemin : Racines, queues d’artichauts sauvages (guernouds), caroubes, tout cela avec l’aimable autorisation de nos gardiens.
Tout manquement et tout fallacieux prétexte peut donner lieu à une distribution gratuite et néanmoins copieuse de coups.
Plusieurs semaines se sont écoulées.
Quand une nuit, le convoi s’approche d’un village d’où émanent les cris plaintifs de quelques chiens faméliques et néanmoins kabyles. Les émissaires s’assurent que les habitants sont toujours disposés à accueillir les prisonniers et qu’aucun danger n’est à signaler.
Après les rituels de politesse, nous sommes invités à pénétrer dans un des gourbis pour nous reposer et attendre le jour.
La nuit a été courte et nous devons repartir pour rejoindre un nouveau site tranquille. Dans l’urgence, nous construisons une baraque de fortune à l’aide de branchages et de tôles ondulées.
Un pseudo confort s’instaure. Certains ont alors recours au système D. Ainsi le plâtrier de Boufarik et principal bâtisseur de la cabane récupère une plaque d’écorce de liège pour s’en faire un matelas isolant, certes dur, mais plus confortable que le sac de toile jeté au sol sur la terre battue.
Les journées se font plus rythmées. Pour autant, l’effectif de nos compagnons d’infortune a baissé. Ils n’ont pas supporté plus longtemps les rigueurs de la captivité et ont tiré leur révérence.
Chacun remplit son rôle en fonction de ses capacités ou de ses aspirations. Ainsi le plâtrier se charge d’ensevelir les morts tandis que Champigny endosse l’habit d’aumônier en récitant la prière des morts à chaque ensevelissement.
Il reste en tout et pour tout sept civils et six militaires gardés par une trentaine de gardiens.
Prétendre qu’il existe, dans de telles situations, une complicité entre prisonniers et gardiens en vue d’un objectif tacitement défini serait juste s’il n’y avait pas une absence de solidarité dès que surgit une gêne commune comme la faim, la soif ou la peur. Là, le chacun pour soi prévaut.
8
A ces considérations s’ajoute l’emprise des gardiens exercée sur les prisonniers, tout simplement alimentée par la nature de la situation.
Les origines, les antécédents et l’état de santé de chacun d’entre eux sont assez disparates. Leur existence en sera plus ou moins vite interrompue. Ce sera le cas de Rihouat que je considérais comme mon frère et dont la fin brutale fut pour moi une tragédie.
C’est par une journée maussade après une nuit mouvementée, perturbée par des chacals et le cri des chiens hurlant à la mort que se déroulent ces faits.
Toute la nuit donc, les chacals ont rodés faisant hurler les chiens à la mort. On entendait des cris, des pleurs et les coups ont volés jusqu’au petit matin.
De plus, le crachin pénétrant a rendu les gardiens nerveux qui somment les prisonniers de sortir de leur cabane encore somnolant pour certains pour s’atteler à la tâche quotidienne de corvée d’eau. Ces corvées d’eau, le matin, ou encore de bois, le soir, sont mal acceptées et l’on renâcle de part et d’autre. Cependant que la distribution inexpliquée de coups demeure le passe-temps favori de nos geôliers, un exutoire en quelque sorte.
Voilà que l’après-midi, deux de ces gardiens viennent chercher un prisonnier pris au hasard. Celui qui est désigné est inquiet du sort qui lui est réservé. Aussi le plâtrier le rassure en ces termes :
-N’ai pas peur ils ne te tueront pas !
Après avoir été copieusement rossé et sous la menace, relate des propos de son camarade de détention. Les deux gardes le ramènent alors et entreprennent de questionner Boufarik, le fameux camarade cité.
-Pourquoi, tu lui as dit ça ? Demande les gardes à Boufarik en parlant de son camarade.
-Moi, je lui ai rien dit, répond Boufarik
-Très bien, Boufarik, puisque tu ne lui as rien dit, ça va être ton tour. Viens par là
9
Le processus d’humiliation reprend. Le malheureux est frappé au ventre. Il tombe à genoux. Fort de son opiniâtreté, il se relève instantanément malgré la chaîne qui enserre ses poignets.
Un nouveau coup asséné le plie en deux et un autre sur la nuque le jette au sol.
Il se relève à nouveau et la séance s’éternise.
Il se retrouve allongé sur le dos dans une tranchée creusée la veille par des prisonniers. Un fellagha s’assoit sur son ventre et lui appliquant sous la gorge un couteau à long manche, lui recommande de prier.
La victime rétorque avec l’aplomb de la jeunesse :
- J’ai pas peur de mourir et d’abord, j’ai jamais prié, c’est pas maintenant que je vais commencer !
Derrière le bourreau, un responsable intervient et s’interpose.
- Allez, ça va, laisse-le. Il est courageux. Il est de chez nous. On verra la prochaine fois !
Et le prisonnier est ramené parmi ses compagnons d’infortune qui lui dirent :
- On a eu peur pour toi !
- Pas de crainte, ils ne tuent jamais ceux qui leur tiennent tête, c’est dans la nature des hommes !
Mais laissons la parole au narrateur que ses camarades avaient surnommé Boufarik à cause de son origine.
La routine reprend ses droits. On attend le matin et ainsi de suite.
Les repas, bien que frugaux, sont une occupation qui rythment la journée.
10
Revenons à la fin tragique de celui que je considérais comme mon frère. Plein de bonté et de gentillesse, ce jeune appelé du contingent avait tout juste vingt ans. Il abhorrait la bestialité et ne comprenait pas qu’elle puisse exister. Il ignorait qu’il en serait la victime innocente.
Ce jour-là, qui était le premier du reste de sa vie, fut également le dernier.
Assis sur un caillou, les pieds dans la boue, la tête pendante entre les jambes, il pleurnichait. De temps en temps, il gémissait :
- J’en ai marre, j’en ai marre, j’en ai marre !...
Au bout d’un moment, deux des geôliers, après un bref conciliabule, s’écartèrent de leur poste. Le plus jeune des deux, il ne devait pas avoir seize ans, se dirigea alors vers le dépité et le saisissant d’une main par les cheveux, lui bascula la tête en arrière et d’un geste vif, lui trancha la gorge à l’aide du couteau-rasoir qu’il dissimulait derrière son dos
Puis tranquillement, l‘exécuteur des basses œuvres s’en retourna vaquer à ses occupations, satisfait d’avoir accompli sa sinistre besogne
La scène a été si rapide que personne ne réalise encore que Rihouat n’en aura désormais plus marre. Il s’est affaissé sur le flanc dans une flaque de son sang mêlé de boue.
11
Ce 29 décembre 1958, alors que tout espoir de survie s’amenuise, la venue du colonel Amirouche, chef de la Willaya trois(Kabylie) est annoncée.
Nous devons ranger les couvertures qui nous servent de literie. Un peu plus tard dans la journée, Le Tueur de l’Akfedou fait son apparition.
Toujours égal à sa réputation, son regard perçant et sa fine moustache noire impressionne. Il est vêtu de son habituelle gabardine, le pistolet passé dans le ceinturon qui lui serre la taille.
Des guêtres en cuir recouvrent ses souliers. Il est coiffé de son éternel calot de police.
Les questions posées aux par le colonel aux prisonniers rassemblés confirme que celui-ci est parfaitement au courant de leurs conditions d’enlèvement. Sa curiosité serait plutôt orientée vers l’origine métropolitaine de ceux-ci.
- Alors toi, d’où tu es ?
- De Bordeaux !
- Et toi ?
- De Sète !
Pour détendre l’atmosphère, le colonel invite les prisonniers à exposer leurs récriminations. Et de conclure :
- Vous savez, ici, dès qu’il y a un problème, on le règle grâce à ça, dit-il en tapotant son pistolet !
- Et toi, tu viens d’où,
- De Boufarik !
Alors, un sourire illumine le visage d’Amirouche.
- Vous, les pieds-noirs, vous êtes tous des assassins des bandits !
- Est-ce que tu as tué un des nôtres ?
- Je n’en sais rien, quand on m’a tiré dessus, j’ai riposté au jugé !
Le prisonnier n’en mène pas large car l’interrogatoire est pesant et dans ce genre de situation, moins on en dit et moins on a la chance de dire une bêtise.
Le regard accusateur d’Amirouche en dit long sur ses intentions, l’avenir se fait incertain.
Après son départ, chaque jour sera un jour de plus à vivre. L’espoir s’amenuise mais la vie continue…
Nous passions le plus clair de notre temps à nous épouiller car la vermine nous envahit par manque d’hygiène.
Il y a aussi les longues discussions auxquelles les gardiens parfois prennent part car ils parlent tous le français mais souvent le cœur n’y est pas.
12

Un après-midi, nous devons partir en catastrophe. Un ratissage est repéré dans les alentours. Les hélicoptères à très basse altitude larguent des soldats très bien armés. Il s’agit cette fois d’une opération d’envergure. Et contrairement à l’habitude, les rebelles n’ont pas été prévenus la veille…
L’effet de surprise nous met mal à l’aise car nous devons nous déplacer continuellement de jour comme de nuit. La nuit est très noire et soudain, nous tombons sur le dispositif mis en place par les soldats français.
- Halte-là ! Qui va là ?
- Fait pas le con, c’est moi, répond un de nos gardes dans un français impeccable
Et en avançant, il ajoute :
- Ce soir, on voit rien !
- Putain, vous m’avez fait peur, rétorque la sentinelle
Ouf, nous sommes passés au travers et nous pouvons progresser. Je n’ose pas penser à la fusillade qui se serait déclenchée si la supercherie avait échouée.
Heureusement que les chaines qui nous entravaient avaient été retirées. C’est dans ces situations que l’on mesure l’objectif commun.

-
Pierre Philippe PLASAULES, utilise la gouache pour traduire les paysages de l'Hérault. Pierre Philippe PLASAULES dans son atelier des mouettes
-
Loetitia LEGRAND et son Panel d'aquarelles POP'S 60X70 9
Aquarelles de grand format 60X70 semi-abstrait où l'imagination se fait dessin puis couleurs dans des imbrications insolites -
Loetitia LEGRAND Aquarelles figuratives 2
Eaux de l'étang de l'or près de Montpellier, aquarelles -
Manman quelle tchatche! de Pierre Philippe PLASAULES
Un livre de 144 pages, de récits tendres et émouvants, des rigolades, d'histoires à ne pas mettre entre toutes les mains.
Ajouter un commentaire